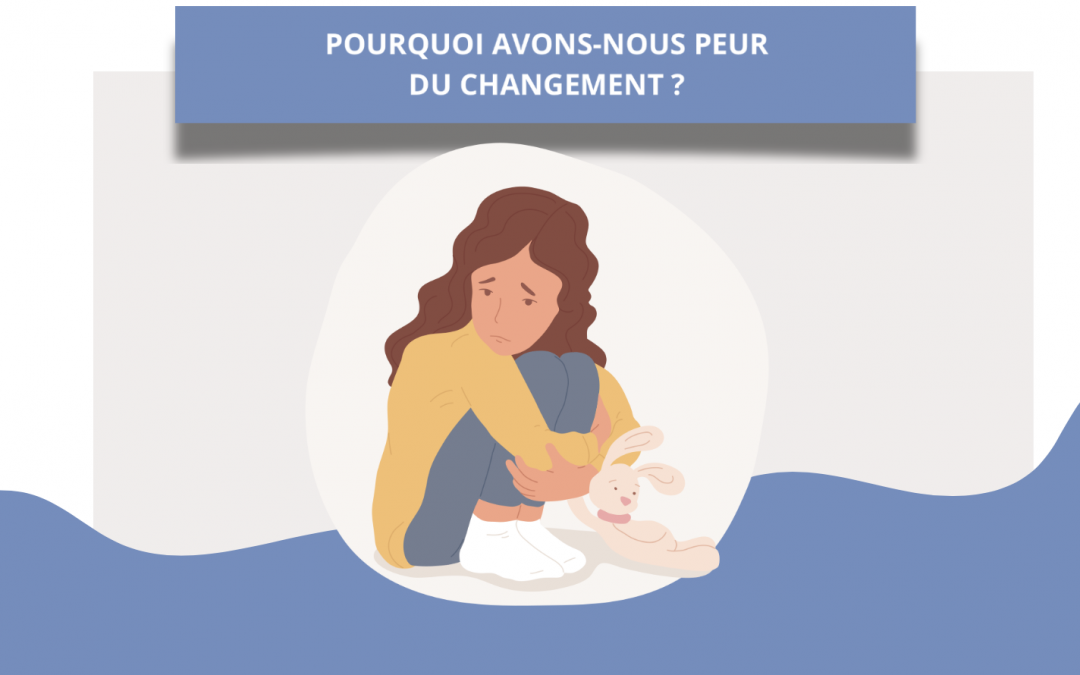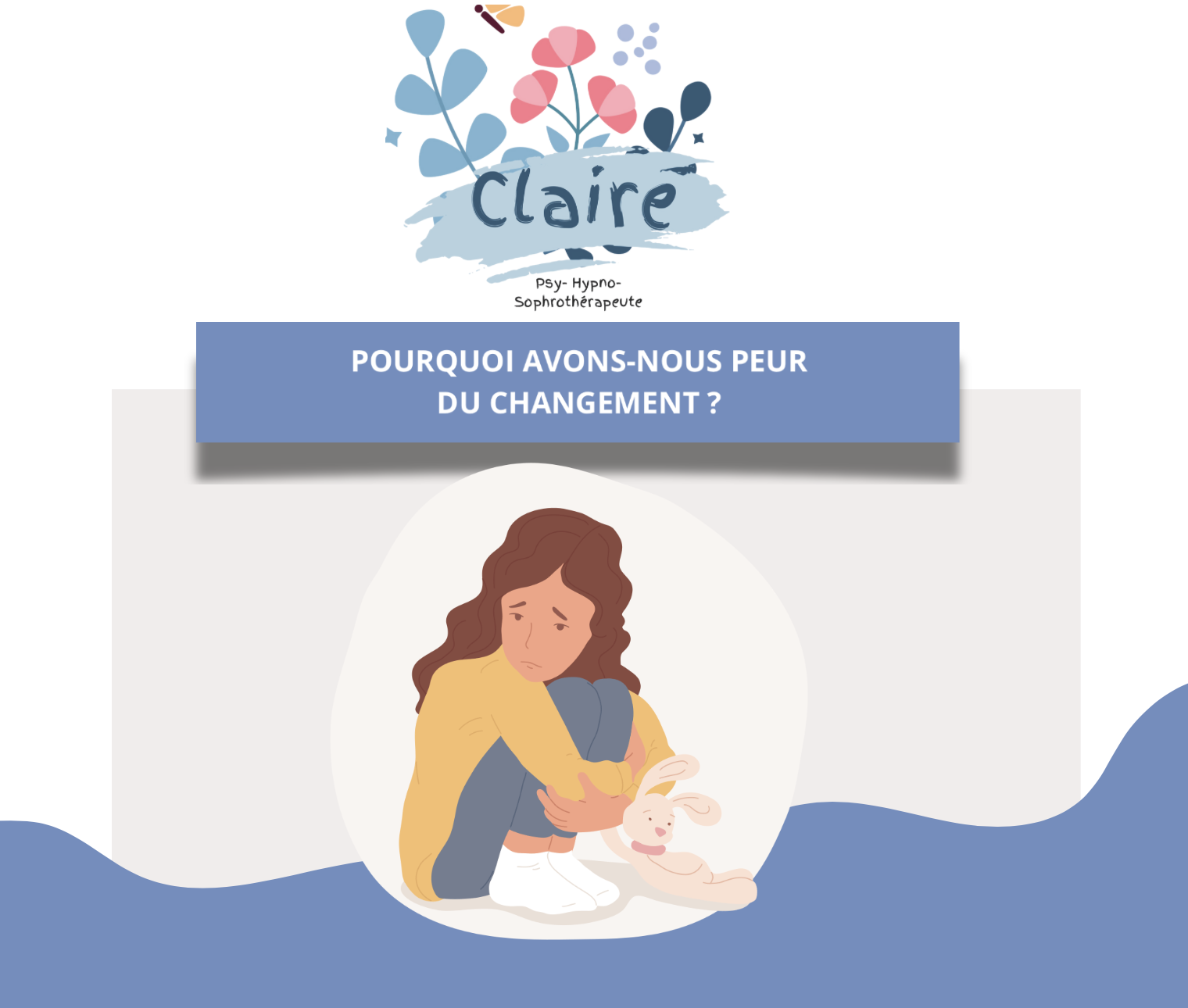Une exploration psychique, symbolique et transgénérationnelle de nos résistances à l’inconnu
Changer. Le mot est partout. Dans les livres de développement personnel, les slogans de coaching,
les thérapies. On nous invite à “sortir de notre zone de confort”, à “oser le renouveau”, à “devenir la meilleure version de soi-même”. Pourtant, derrière ces injonctions à l’évolution, se cache une vérité plus complexe, plus humaine : le changement fait peur.
Pas toujours. Mais souvent. Même lorsque la situation actuelle nous fait souffrir, même lorsque l’on sait que « l’autre rive » serait plus douce… on hésite, on résiste, on freine, ou on sabote. Pourquoi ? Parce que le changement ne touche pas que le mental. Il vient ébranler des couches profondes de notre psyché. Il vient réveiller nos attachements inconscients, nos mémoires anciennes, et nos peurs les plus archaïques.
Le changement : entre élan de vie et menace inconsciente
À première vue, changer semble une action volontaire, rationnelle : déménager, changer de travail, quitter une relation, transformer une habitude… Mais sur le plan psychique, changer signifie mourir à une ancienne version de soi. Et cela, notre inconscient le vit comme une menace existentielle.
En psychanalyse, on sait que le Moi cherche à maintenir l’équilibre, même s’il est douloureux. Tout changement active donc des mécanismes de défense : rationalisation, évitement, procrastination, peur du jugement, ou symptômes physiques.
Pourquoi ? Parce que derrière le changement, il y a toujours la perte. Perte de repères, d’identité, d’attachements connus, même toxiques.
Changer, c’est donc :
-
quitter une structure familière,
-
affronter l’incertitude,
-
accepter l’inconnu,
-
et surtout… devenir quelqu’un d’autre.
Et cette mutation, même si elle est choisie, peut réveiller une panique archaïque.
Le changement menace notre identité psychique
Le changement menace notre identité psychique
Notre identité psychique est un édifice complexe, bâti depuis l’enfance, souvent sur des bases inconscientes. Elle s’est construite autour de ce que nous avons vécu, cru, ressenti. Elle inclut des mécanismes d’adaptation, des rôles familiaux, des croyances sur le monde et sur nous-mêmes.
Changer, c’est toucher à cet édifice. C’est dire à notre inconscient :
“Tu sais cette vieille stratégie qui te protégeait ? On va l’abandonner.”
Et lui répond :
“Non merci. Mieux vaut le connu, même douloureux, que l’inconnu, même porteur d’espoir.”
C’est pourquoi, paradoxalement, on peut avoir peur de réussir, autant que de rater. Réussir suppose de devenir autre. D’être vu autrement. De ne plus avoir les mêmes excuses, les mêmes blessures, les mêmes besoins.
Le changement active la mémoire traumatique
Beaucoup d’entre nous ont vécu des ruptures brutales dans leur histoire personnelle : divorce parental, déménagements, pertes affectives, instabilité émotionnelle.
Ces événements créent des empreintes émotionnelles profondes. Et si ces expériences de rupture ont été associées à de la douleur, de l’insécurité ou du rejet, alors l’idée même de “changement” devient traumatique.
Chaque nouveau changement réactive alors une mémoire corporelle : un état de vigilance, d’angoisse, voire de panique.
La peur du changement n’est donc pas irrationnelle. Elle est liée à une tentative de protection, souvent inconsciente, qui veut nous éviter de “revivre” ce qui a déjà été vécu comme une perte ou un chaos.
Le changement, vu par le symbolique : une mort et une renaissance
Dans toutes les traditions initiatiques, le changement est assimilé à une mort symbolique. L’ancien moi doit “mourir” pour que le nouveau puisse naître. C’est le parcours du héros, le passage dans l’ombre, le désert intérieur. Et ce passage est souvent douloureux.
Pourquoi ? Parce que l’inconnu est un espace non symbolisé. Tant qu’on n’a pas vécu le changement, il reste un “trou” dans notre carte mentale. Et l’inconscient, comme l’enfant, craint ce qu’il ne connaît pas.
Les mythes, les contes, les rituels parlent tous de cette crise de transition. Elle est nécessaire pour accéder à une forme plus mature, plus libre, plus authentique de soi. Mais elle demande de traverser une forme de chaos temporaire. Et beaucoup reculent au seuil.
Les loyautés invisibles et les freins transgénérationnels
Changer, c’est aussi risquer de trahir sa lignée. Cela peut sembler incongru, mais en psychogénéalogie, on observe fréquemment que :
-
certaines personnes s’interdisent de réussir parce que personne ne l’a fait dans leur famille ;
-
d’autres s’autosabotent dès que la vie devient plus douce, comme s’ils portaient une dette familiale à expier ;
-
certains reproduisent des schémas familiaux destructeurs pour rester “fidèles” à leurs origines.
Ces loyautés inconscientes peuvent nous empêcher de franchir le cap d’un changement salutaire.
L’inconscient familial peut dire :
“Si tu changes, tu n’es plus des nôtres.”
Et c’est un conflit d’appartenance extrêmement douloureux.
Les formes déguisées de la peur du changement
La peur du changement ne se manifeste pas toujours frontalement. Elle peut prendre des formes subtiles, masquées :
-
Procrastination chronique : “Je le ferai demain.”
-
Hyperactivité de surface : faire plein de choses inutiles pour éviter de faire la seule qui compte.
-
Syndrome de l’imposteur : “Je ne suis pas légitime.”
-
Recherche perpétuelle d’informations sans passage à l’action.
-
Auto-sabotage relationnel ou professionnel.
-
Crises “inexplicables” au moment où tout va bien.
Toutes ces manifestations peuvent être des résistances inconscientes au changement, même positif.
Comment dépasser cette peur ? Des pistes concrètes
Changer ne se décrète pas. Ça se prépare, ça se ressent, ça se traverse. Voici quelques pistes pour accueillir le changement sans se brutaliser :
🔸 Nommer sa peur
Dire : “J’ai peur de changer” n’est pas un aveu de faiblesse. C’est une reconnaissance d’une part de soi qui cherche à se protéger. L’accueillir, c’est déjà commencer à la désamorcer.
Identifier ce qu’on perd… mais aussi ce qu’on gagne
Fais deux colonnes :
-
Ce que je perds si je change
-
Ce que je gagne si je change
Le cerveau focalise souvent sur la perte. Mais en visualisant concrètement les bénéfices du changement, on peut rééquilibrer l’élan.
🔸 Repérer les croyances associées au changement
-
« Si je réussis, je vais être rejeté(e). »
-
« Si je change, je ne serai plus aimé(e). »
-
« Si je quitte cette situation, je serai seul(e). »
Ces croyances sont souvent héritées ou issues de blessures anciennes. Les déconstruire permet de libérer l’élan vital.
🔸Travailler sur les loyautés familiales
Pose-toi la question :
“Qui est-ce que je trahirais si je changeais ?”
Et ensuite :
“Et si, au lieu de trahir, je leur montrais un autre chemin possible ?”
Changer peut aussi être un acte d’amour envers sa lignée : en la libérant d’un cycle, en l’honorant autrement.
🔸 Faire un pas à la fois
Changer ne veut pas dire tout bouleverser. Un petit pas, cohérent, authentique, a souvent plus de puissance qu’un saut spectaculaire non intégré.
la peur du changement n’est pas à vaincre… mais à traverser
Avoir peur du changement ne signifie pas qu’on est faible, indécis ou en échec. Cela signifie qu’on est humain, avec une psyché riche, des blessures, des fidélités, et des ombres.
La véritable évolution ne consiste pas à ignorer la peur, mais à l’écouter, la comprendre, l’apprivoiser.
À poser la main sur son cœur et lui dire :
“Je t’entends. Tu veux me protéger. Mais maintenant, je peux avancer différemment.”
Changer, ce n’est pas devenir quelqu’un d’autre.
C’est se rapprocher de soi-même, en laissant mourir ce qui ne nous sert plus.
Et cela, oui, demande du courage. Mais ce courage, tu l’as déjà en toi.
Il suffit d’un premier pas.